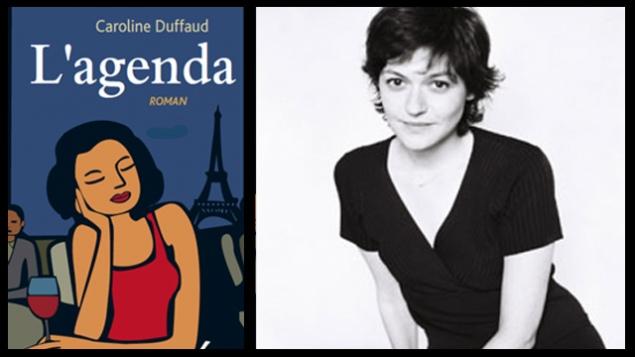Interview de Thomas Chaudron qui nous partage sa vision d’un spécialiste de l’entrepreneuriat
Quelles sont les caractéristiques communes des entrepreneurs que vous rencontrez ?
Le point commun entre tous ces entrepreneurs ? C’est qu’ils ont pris et qu’ils prennent tous les jours des risques. Entreprendre est un acte audacieux, il faut avoir une certaine dose de folie pour se lancer dans l’inconnu. D’ailleurs l’idée de liberté est très ancrée dans l’esprit de ces aventuriers. Mais attention, il ne s’agit pas de la liberté telle que celle des « sauvages » dont parlait Rousseau, car certaines contraintes (comme les attentes des clients par exemple) sont omniprésentes.
Etre entrepreneur ce n’est pas faire ce que l’on veut quand on veut !
On remarque également que le gain important et immédiat est rarement une motivation première. En effet, pour percevoir vraiment de grosses sommes d’argent, il faut déjà avoir constitué une entreprise de taille conséquente. En fait, si l’on veut gagner beaucoup d’argent, il vaut mieux en général privilégier un parcours dans les grands groupes.
Enfin, une dernière caractéristique que partagent les entrepreneurs que je rencontre, consiste dans l’envie de progrès, d’une remise en cause personnelle et professionnelle constante. Il existe beaucoup de formations, mais peu offrent un réel apprentissage des savoirs nécessaires pour entreprendre. Or, au CJD, nous considérons qu’être entrepreneur, c’est un métier à part entière et qu’au-delà de savoirs techniques (comptabilité, gestion, management…) et de savoirs personnels (qualités humaines), d’autres types de compétences restent à acquérir pour être un vrai professionnel.
Je suis conscient, cependant, que les entrepreneurs du CJD ne représentent pas tous les types d’entrepreneurs. En effet, les adhérents partagent des valeurs communes dont celle de mettre l’économie au service des hommes. C’est pourquoi le CJD n’a pas vocation à rassembler tous les jeunes dirigeants mais à rassembler des dirigeants, jeunes, qui possèdent d’abord une approche humaniste de l’entrepreneuriat.
Quelles sont les qualités que doivent avoir les entrepreneurs ?
L’expression, qui représente bien pour moi l’entrepreneur idéal, s’exprime par la maxime : « la tête dans les étoiles et les pieds dans la glaise ». Autrement dit, il faut voir loin et agir localement. On peut citer également les qualités personnelles nécessaires comme l’humilité, car rien n’est jamais acquis ni gagné, ou encore la ténacité, mais aussi, et c’est peut être le plus important, le respect car c’est en respectant que vous serez respecté. Et sans respect, il ne peut y avoir de confiance, élément fondamental pour toute entreprise humaine. Respecter les collaborateurs, les clients, les fournisseurs ou l’environnement, sont forcément une des qualités de bases pour un entrepreneur. Sinon, il n’aura aucune chance de réussir dans la durée !
Quels ont été vos premiers défis ? Comment les avez-vous dépassés ?
Le premier défi que j’ai rencontré, à l’âge de 23 ans, était celui de me faire accepter comme patron car la propriété du capital n’amène pas pour autant l’autorité. Il a donc fallu que je m’impose comme dirigeant et pas uniquement comme actionnaire majoritaire de l’entreprise que je venais de créer. En réalité, ce défi je l’ai franchi non pas en agissant sur les autres mais en progressant moi-même, en me professionnalisant dans mon métier et en apprenant de mes erreurs.
Le deuxième défi fut la difficulté à prendre de la hauteur. De manière imagée, on peut vouloir pédaler de plus en plus vite mais tout ce que l’on va faire, si on va dans le mur, c’est juste se faire encore plus mal au moment de l’impact. Il faut donc rapidement réussir à prendre du recul afin d’acquérir une vision à moyen terme pour son entreprise et se faire une idée objective des raisons du succès et des échecs. Le troisième défi, ce fut bien sûr de trouver et fidéliser les clients !
Que doit faire l’entrepreneur en priorité ?
Une entreprise représente un système complexe, qui doit être appréhendée comme un tout.
La grande difficulté pour l’entrepreneur réside dans le fait qu’il ne peut pas juste segmenter ses activités pour avoir une vision claire et précise de ce « tout ». En effet, les interactions générées par ses différentes actions ne sont pas mesurables, et pourtant c’est en cela que réside la richesse de ce métier : impossible de se dire « lundi je m’occupe des collaborateurs, mardi des clients, mercredi des actionnaires etc.. ». Les décisions du lundi auront un impact les jours suivants et réciproquement. C’est pourquoi, la première tâche consiste à bien définir une vision et une stratégie à moyen terme, pour avoir un cap et s’y fixer dans les décisions de tous les jours. C’est, à mon avis, la seule possibilité pour donner un sens et une cohérence aux priorités définies.
« N’importe qui peut devenir entrepreneur » : que pensez-vous de cette affirmation ?
Tout dépend de ce que l’on entend par le mot « entrepreneur ». Si on parle simplement de constituer une structure juridique, d’en apporter le capital social initial et de prendre la tête de cette structure, tout le monde peut le faire. Mais si, par le mot entrepreneur, on désigne quelqu’un qui veut aller de l’avant, qui prend un risque et qui l’assume, je pense que la part de la population concernée devient plus faible. D’ailleurs, je ne lie pas la propriété du capital à cette qualité : on peut tout à fait être entrepreneur dans sa vie ou dans son entreprise.
Que suggérez-vous pour faciliter la tâche des dirigeants d’entreprise ?
On peut toujours considérer que l’herbe sera toujours plus verte ailleurs, mais je pense qu’il faut aussi savoir s’accommoder des contraintes et composer avec elles.
Bien sur, des progrès pourraient être faits avec moins de nouvelles lois et une meilleure application de celles déjà en vigueur. L’enjeu réside aujourd’hui dans l’évolution vers une plus grande équité des entreprises face à la loi. Et pour que la notion d’équité devienne une réalité, il faudrait admettre que toutes les entreprises ne sont pas équivalentes.
Peut-on en effet traiter de la même manière le cas d’une entreprise cotée au CAC 40 et celui d’une PME ?
Toutes les sociétés ne peuvent pas être régies par les mêmes règles de droit car leurs enjeux restent différents. Pour autant, je me méfie des décisions hâtives qui consistent à supprimer toutes les obligations et contraintes sous prétexte que les PME n’ont pas systématiquement les moyens de s’y adapter. N’oublions pas que l’enjeu majeur des années qui viennent se trouve dans la pénurie de main d’œuvre. Il faut donc arriver à une voie médiane grâce à laquelle on permettra aux PME de vivre et de se développer plus facilement sans leur enlever les moyens d’attirer les nouveaux collaborateurs dont elles auront besoin. Certaines idées séduisantes, de prime abord, se sont surtout soldées au final par un écart encore plus grand entre les PME et les grands groupes en termes d’attractivité. C’est un écueil à absolument éviter.
Quelles seraient les mesures nécessaires pour favoriser le développement des entreprises françaises à l’étranger ?
Il faudrait encourager les grands groupes à accompagner les PME à l’export. Certes, on ressent une véritable frilosité chez nombre de dirigeants de PME au sujet de l’international. Mais pour beaucoup, leur marché est devenu mondial, et nous avons la chance d’avoir de grands groupes présents partout dans le monde.
Cela sous-entend également que les dirigeants développent leur capacité à travailler en réseau. La conquête à l’étranger reste toujours plus facile lorsqu’on s’y engage à plusieurs : cela permet par exemple de mutualiser les frais de traduction ou d’implantation, etc…
Enfin, sur un mode différent, il faudra aussi revoir le financement de notre protection sociale, qui pèse très fortement sur le travail. Aujourd’hui, à prix d’achat égal de matières premières, l’impact de la masse salariale sur le prix de vente rend les entreprises françaises beaucoup moins compétitives que leurs principales concurrentes européennes.